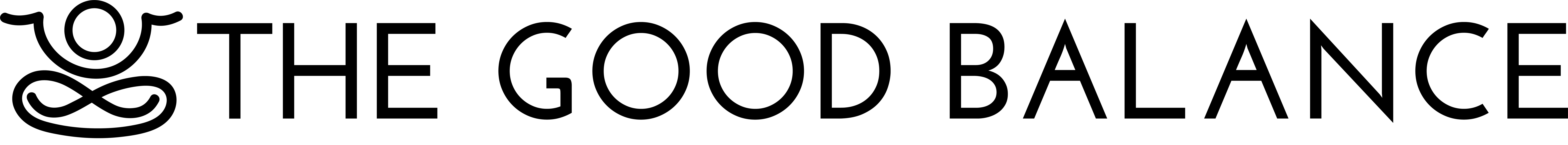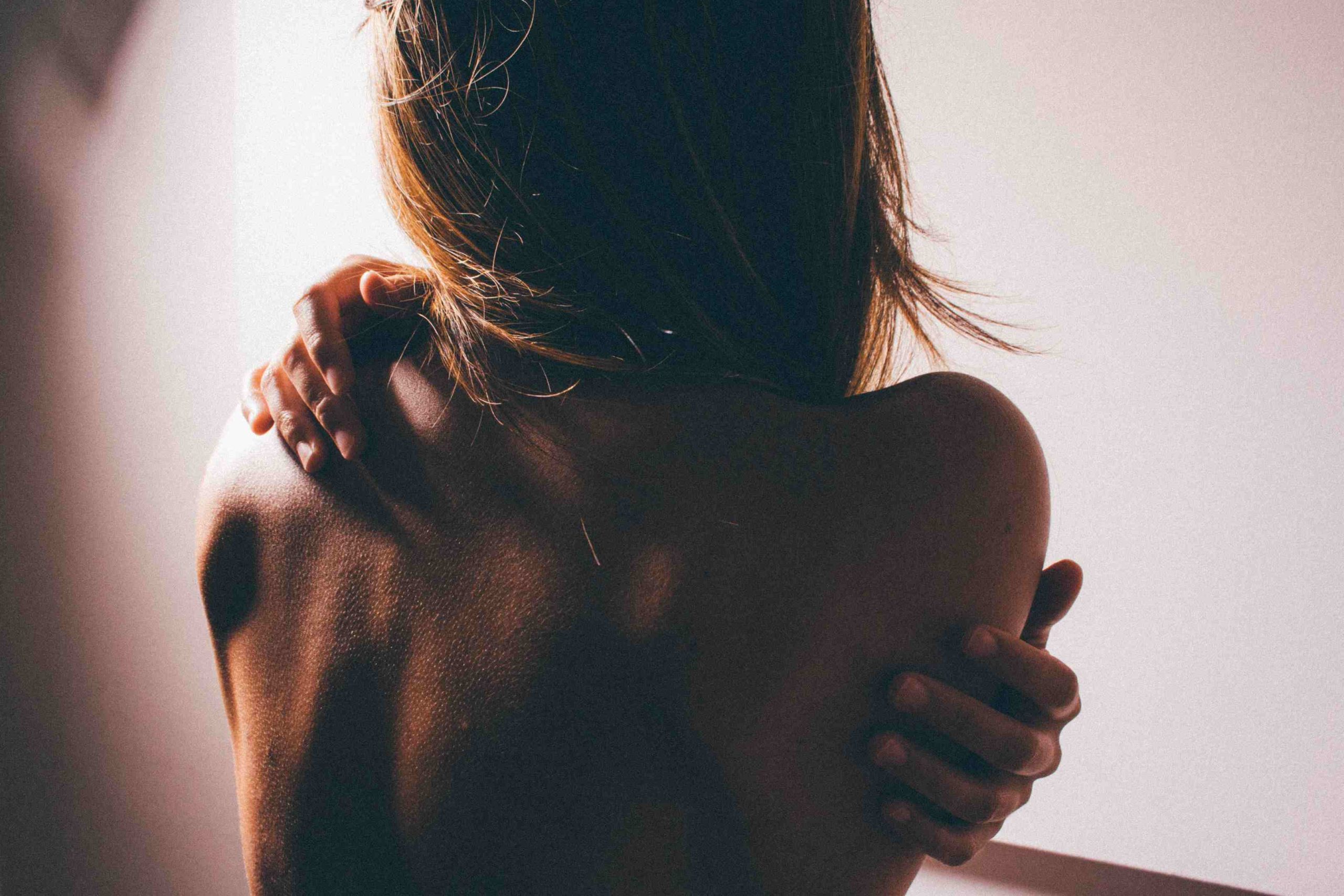L’impermanence des choses
Je ne l’ai peut-être jamais dit ici, mais j’ai une fascination pour les serpents.
Pas au point de me les mettre autour du cou, non non… Mais ils me fascinent de par leur capacité à changer de peau. J’avais d’ailleurs un projet de tatouage sur le bras représentant un immense serpent. Je ne l’ai pas encore fait, un jour, peut-être…
Le serpent est le symbole de l’énergie vitale parce qu’il possède justement la possibilité de changer de peau. Il symbolise le mouvement et l’impermanence. Il est d’ailleurs l’attribut du Dieu Esculape, celui de la guérison.
A dire vrai, lorsque j’étais recouverte d’acné, j’avais beaucoup de mal à encaisser certains changements dans ma vie et cela a eu un impact considérable sur ma santé globale, c’est ce que je vais tâcher de t’expliquer aujourd’hui.
Couper le cordon
Lorsque je faisais de la recherche en sciences humaines et sociales, j’étais enfermée dans une réalité qui était très différente de celles et ceux qui n’appartenaient pas à ce monde.
J’avais mon petit train-train quotidien bien rodé, mes allers-retours France-Inde-Angleterre, lire, lire et encore lire des articles en différentes langues, confortablement installée dans les somptueuses bibliothèques parisiennes et anglaises ; de la bibliothèque nationale de France, en passant par la British Library de Londres, le musée Guimet avenue du Président Wilson, ou le Collège de France, rue du Cardinal Lemoine, pour ne citer qu’elles. Je me rendais à différents séminaires et conférences ici et là, je rédigeais de nombreux travaux, des demandes de financements et je m’affairais à de multiples relectures. Avec du recul, je peux dire que j’ai couché beaucoup de mots sur les pages Word de mon ordinateur… Je sais donc d’où me vient cette passion pour les mots.
Voilà (à peu près) à quoi ressemblait ma vie d’étudiante chercheure, à laquelle il conviendrait d’ajouter à ces activités mondaines : longs voyages en métro, job alimentaire et dodo. Vue d’extérieur (sans le métro, le job alimentaire et le dodo), cela paraissait relativement passionnant ; peut-être même « exotique » pour quelqu’un qui ne connaît pas le milieu de la recherche parisien.
A dire vrai, je me sentais en sécurité dans ce monde très élitiste, très concurrentiel, très fermé et pas forcément très bienveillant (un comble lorsqu’on étudie les sciences humaines d’ailleurs). Étonnamment (ou pas), je n’arrivais pas à « couper le cordon » avec le milieu de la recherche parce que je ne connaissais que cela ; et puis, à dire vrai, appartenir à « l’élite intellectuelle parisienne », avouons-le, cela nourrit l’Ego…
A ce moment de ma vie, tout tournait uniquement autour de mes études et de mes jobs étudiants puisque je ne connaissais que cela ; j’avais d’ailleurs une très mauvaise perception du travail puisque j’enchaînais des jobs étudiants relativement précaires, payés au lance-pierre, emplois que je n’avais clairement pas envie d’exercer toute ma vie. Je me réfugiais donc dans mes « hautes » études parce que c’était ma bouffée d’air et cela me permettait de ne pas trop réfléchir à ce que je pouvais faire d’autre de ma vie. En réalité, c’était inconcevable parce que je ne me voyais pas ailleurs.
Backward
Après mon baccalauréat, j’ai enchaîné sur un BTS en alternance. J’ai vécu un enfer dans l’entreprise qui m’employait à l ‘époque où j’ai subit du harcèlement moral. Le monde du salariat démarrait donc plutôt mal pour moi. A l’obtention de mon diplôme, j’ai enchaîné avec une Licence et deux Masters recherche à la Sorbonne et à l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales. Mes études étaient clairement mon refuge, j’étais prête à y rester toute ma vie, à être doctorante, post-doctorante, quitte à enchaîner les contrats précaires dans la recherche dans le but de « me faire un nom », et surtout d’éviter à tout prix ces autres jobs précaires dans le commerce ou la restauration.
A dire vrai, je ne sais pas ce qui était le plus précaire entre s’entêter à faire des études dans un milieu où les opportunités professionnelles étaient limitées et ces autres jobs alimentaires qui ne me plaisaient guère. Mais mes études me nourrissaient et me stimulaient intellectuellement ; j’étais donc prête à choisir la précarité financière plutôt que la précarité financière et intellectuelle. C’est triste à dire, mais c’était pourtant ma vérité de l’époque. Je ne connaissais rien d’autre donc je ne savais pas ce qui pouvait me stimuler autrement.

Moi (entourée de mes « discutants ») présentant l’un de mes sujets de recherche lors d’une journée d’étude à l’EHESS en mars 2015 à Paris
Prison mentale
A ce moment de ma vie, je n’avais pas suffisamment confiance en moi.
Aussi, si tu me lis depuis un petit moment, tu sais probablement que je suis introvertie et que j’ai eu dans le passé des difficultés à aller au contact des gens sans ma casquette de chercheure. Ce n’est pas quelque chose de naturel chez moi et cela a eu un immense impact sur ma vie professionnelle à mes débuts. Mais être introvertie ne veut pas forcément dire ne pas avoir confiance en soi. En ce qui me concerne, j’étais introvertie et je n’avais pas confiance en moi…
Je n’osais pas vraiment aller vers les gens et observer ce qu’il se passait ailleurs, en dehors de la recherche, parce que je me considérais bloquée avec mes diplômes qui ne « servaient à rien ». J’étais bourrée de croyances : « je ne suis pas fille « de », « je ne connais personne qui pourrait me pistonner », « il n’y a que les riches qui réussissent », « mes diplômes me mèneront à rien malgré mon haut niveau d’étude ». Je n’avais absolument pas conscience de mes qualités et de ce que je pouvais offrir au monde et encore moins que tout ce que j’avais intégré durant toutes ces années m’avaient énormément appris sur moi et sur le monde. Mais j’avais une bien triste estime et opinion de moi-même.
Je n’avais pas conscience que j’étais en réalité quelqu’un de libre, probablement bien plus que ceux qui donnaient l’impression de « réussir » dans leur vie. J’étais libre de faire ce que je voulais, quand je le voulais, parce que personne n’attendait de moi que je fasse la même chose que « papa » ou « maman ».
En toute sincérité, j’en ai longtemps voulu à mes parents de ne pas m’avoir soutenue financièrement pendant mes études. Mais aujourd’hui, je les remercie de ne pas être intervenus dans mes choix et de m’avoir laissée expérimenter mon propre chemin, même si cela a parfois été très dur.
Oui, j’aurais peut-être aimé qu’ils me soutiennent un peu financièrement et qu’ils soient davantage présents pour moi, même s’ils ne partageaient pas mon point de vue et mes choix de vie ; oui, peut-être aurais-je été moins fatiguée, moins anxieuse, moins malade ? Ou peut-être pas ; avec des « si », on refait le monde…
S’ils avaient été plus présents, j’aurais peut-être terminé par me laisser convaincre à faire ce qu’ils jugeaient bon pour moi, je ne me serais plus écoutée et je serais probablement tombée malade autrement, parce que j’aurais dépendu d’eux financièrement, et je me serais sentie redevable…
Selon moi, la pire chose qui puisse nous limiter dans notre vie, c’est dépendre de quelqu’un et se sentir redevable.
Sortir de sa zone de confort
Lorsque je prends du recul sur ma situation de l’époque, je me rends compte que je n’ai pas vraiment persévéré, je n’ai jamais testé de faire différemment, j’ai peut-être dû envoyer 2 ou 3 CV qui n’ont probablement jamais été lus, et je me suis rapidement résignée en me confortant dans mes idées préconçues : « mes hautes études ne servent à rien », « je ne pourrais rien faire avec cela » et « je ne suis personne ».
Enfermée dans mes croyances bien ancrées, je ne suis jamais sortie de ma zone de confort pour tester d’autres choses et pour rencontrer de nouvelles personnes. Je restais dans le milieu de la recherche puisque je ne connaissais que cela. Bien que je ne me sentais pas vraiment respectée, je préférais rester dans un environnement qui ne m’apportait aucune joie et aucune perspective de vie complètement épanouissante. J’avais très peur de me retrouver dans quelque chose de moins palpitant. Je me complaisais là dedans tout simplement.
Après ma soutenance à l’EHESS, j’ai vécu un véritable choc parce que j’avais la possibilité de continuer dans le milieu de la recherche alors que je ne m’y attendais pas du tout. Je ne l’ai pas fait et je crois que c’est la meilleure décision que j’ai prise dans ma vie.
J’étais à bout de souffle, mon visage était recouvert d’acné, je sentais que ce monde ne me convenait pas, je n’y trouvais pas ma place, je me sentais vide et probablement à la limite de la dépression. Rien de ce que je faisais n’avait un sens en réalité. Mon sujet de recherche était très pointu et n’intéressait personne hormis une poignée de chercheurs. Je n’apportais pas vraiment grand chose au monde. A ce moment là, je peux dire que j’ai vécu une forme de « deuil », parce que c’était une véritable perte pour moi : je perdais tout mes repères. Je coupais le cordon avec quelque chose qui me rassurait.
L’alternative
En réalité, je ne savais pas quoi faire d’autre de ma vie. Puisque je ne continuais pas dans la recherche, la suite « logique », était donc, selon mes croyances, d’enseigner. Je suivrais alors le même chemin que tous les autres étudiants qui n’avaient pas pu et/ou souhaité continuer dans le milieu de la recherche faute de financements, ou faute de savoir ce qu’ils pouvaient bien faire de plus excitant ; nombreux sont ceux qui passèrent les concours de l’enseignement sans grande conviction et sans véritable intérêt pour cela…Tout bonnement parce que c’était la seule voie sécurisante pour eux. Je pouvais tout à fait le comprendre, c’était sécurisant pour moi aussi, même si j’aimais vraiment enseigner.
Pendant ces longues années d’étude, j’étais donc recouverte d’acné adulte. Je me sentais perdue, j’avançais seule contre vents et marées, et je m’épuisais à travailler de manière acharnée pour faire plaisir à ma directrice de recherche. J’étais addict à la caféine ; en d’autres termes, j’étais addict à l’adrénaline parce que cela me permettait de tenir physiquement en mentalement… J’étais incapable de m’arrêter parce que si je m’arrêtais, je savais que je sombrerais. Pour moi, je crois que le vide était synonyme de mort physique et cérébrale. Je n’avais plus aucun loisir et tout tournait autour de mes recherches dans ma vie, c’était une obsession. Je ne m’alimentais pas très bien, j’étais très sédentaire, je n’étais plus vraiment une personne, simplement un cerveau qui produisait du contenu non stop et devait répondre à des critères indiscutables. Je ne m’arrêtais plus, dans l’énergie masculine « yang » en permanence, mon système nerveux parasympathique, notre frein naturel, n’était absolument plus sollicité. J’étais coupée de mon corps, en tension permanente donc je ne ressentais plus rien.

Crédit photo : Christopher Ott
Burn in
Je m’épuisais et je m’enflammais de plus en plus de l’intérieur parce que ma directrice me pressait comme un citron de toutes parts. Elle voulait tirer le meilleur de moi-même, je le sais bien, mais je subissais ainsi mon sort sans rien dire. A l’époque, je pense que j’étais à la limite du burn out. Mon corps me criait que j’étais mal en point et qu’il fallait absolument que j’arrête de me faire subir tout cela…
Pourtant, je continuais encore et encore parce que j’avais des dead lines à respecter et que ce sont probablement mes amis le cortisol et l’adrénaline que je sécrétais en masse, qui me permettaient de « survivre ».
J’étais en lutte contre moi-même, déconnectée de mon corps, je prenais du poids, je me réfugiais dans le mental, à me focaliser sur mes recherches et ma réussite pour faire plaisir aux autres pour la réussite « sociale ». J’avais le sentiment que je maîtrisais ma vie mais j’étais dans le déni le plus total, j’étais en pilote automatique, je résistais et je n’étais clairement pas épanouie dans celle-ci. Je vivais ce qu’on appelle le stress chronique « le burn in », celui que l’on ne ressent plus.
Le « burn-in » est l’étape de résistance au stress juste avant de tomber dans le célèbre burn out. Cette condition dont on parle très peu a été exprimée pour la première fois en 1994 par le psychologue américain Cary Cooper.
Dans une situation de « burn-in », comme je viens de l’expliquer via mon expérience personnelle, une personne est surmenée mais elle résiste à dire qu’elle va bien et elle est incapable de s’accorder des pauses pour retrouver de la vitalité. Elle (s’)assure que tout va bien, qu’elle gère son travail, qu’elle se sent un peu fatiguée mais que cela va lui passer. Pourtant, elle continue de travailler encore et encore et elle ne s’accorde aucun moment « off », elle s’épuise peu à peu jusqu’au jour où son corps se chargera de la rappeler à l’ordre. A dire vrai, mieux vaut accepter d’être en « burn in » et ne pas tomber dans la phase de « burn out » dont on peut mettre des mois, voir des années à s’en remettre…

Crédit photo : Sydney Sims
Renaissance
Après être sortie du milieu de la recherche, j’ai eu un moment d’errance … J’ai repris en main mon corps en faisant plus attention à mon alimentation et à mon mode de vie. Je me suis arrêtée de travailler non-stop et l’arrêt a été plutôt brutal, inconfortable même, parce je touchais du doigt la fameuse mort cérébrale et physique dont je parlais précédemment.
Pour moi le vide était inconcevable. Je ne savais pas encore que j’étais en réalité de nature contemplative et que le « vide » n’avait absolument rien de « vide ». Au contraire, je sais aujourd’hui que ce vide stimulait ma créativité et c’était justement parce que je voulais me remplir de toutes part, que je me vidais littéralement de mon énergie de vie.
Je continuais donc de me chercher et j’étais toujours perdue. C’était une période tout aussi anxiogène que celle que je vivais dans la recherche parce que j’avais le sentiment de devoir me justifier auprès des autres. Mes amis signaient des CDI, passaient des concours, j’étais la seule à errer et expérimenter. En plus de cela, je continuais à gérer mes poussées d’acné qui n’en finissaient plus.
Je me sentais épuisée mentalement et physiquement, je ne savais pas comment j’allais pouvoir subvenir à mes besoins. J’avais peur en permanence. Et être dans la peur, c’est être en mode alerte et survie… C’est une condition extrêmement néfaste pour les systèmes nerveux et hormonal. J’avais donc de plus en plus d’acné. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard.
J’ai donc enseigné en collège-lycée, pour faire, selon moi, la seule chose que j’étais capable de faire avec des diplômes en sciences humaines et sociales. J’enchaînais les contrats, mais je continuais toutefois de me former en yoga et à d’autres outils en parallèle qui me permettaient de mieux me comprendre et de m’affirmer.
Progressivement, je muais comme un serpent, je me libérais de croyances sur moi et sur le monde ; j’apprenais à mieux me connaître, à connaître mes limites, et à les respecter. Mon rapport à moi-même changeait au fur et à mesure et je faisais ainsi tomber toutes mes barrières mentales.
Je me sentais comme un serpent. Un reptile grandit tout au long de sa vie contrairement à nous, c’est pour cela qu’il mue régulièrement. J’avais le sentiment de vivre la mue du serpent à ma manière. Je ne grandissait peut-être plus physiquement mais je sentais que je grandissais de l’intérieur, je gagnais en maturité, en autonomie et en confiance en moi.
Et, on aura beau le croire ou non, cela se voyait sur ma peau qui desquamait progressivement et cicatrisait peu à peu a fur et à mesure que je m’affranchissais du regard des autres. Oui, je commençais à me connaître en dehors du regard de ces derniers et je sentais que je m’épanouissais car je vivais beaucoup moins d’émotions désagréables.
L’impact des émotions sur le corps
Même si la science n’a pas encore énormément d’études sur le sujet, on sait aujourd’hui que les émotions ont un impact sur le corps. Selon leur nature et l’intensité de leur ressenti, nous savons qu’elles influencent les systèmes musculosquelettique, hormonal et nerveux de l’être humain.
Nous savons que la sécrétion de nombreuses neurohormones démarrent depuis l’hypophyse ; et cette dernière est connectée directement à notre cerveau limbique via l’hypothalamus.
Le cerveau limbique est considéré par Paul Mac Lean comme le siège des émotions (comme le plaisir, l’agressivité, la colère ou la peur). C’est justement cette partie de notre cerveau qui régit nos comportements selon nos ressentis émotionnels.
Plus spécifiquement, c’est l’antéhypophyse qui sécrète quatre hormones : la FSH, la LH, la TSH et l’ACTH vers des organes cibles, les glandes endocrines (surrénales, thyroïde…), pour les stimuler à produire à leur tour d’autres hormones.
Si nous sommes quelqu’un d’anxieux, que nous stressons en permanence, sans même s’en rendre compte, nous libérons du cortisol et d’autres hormones en dépit d’autres hormones. Le cortisol (ou hydrocortisone) est une hormone stéroïde (corticostéroïde) sécrétée par la partie externe de la glande surrénale, au dessus des reins, à partir du cholestérol. La sécrétion du cortisol dépend donc d’abord de la bonne sécrétion de l’ACTH via l’hypophyse. Notre équilibre hormonal part donc de la base de notre cerveau.
En ce qui me concerne, puisque j’étais une anxieuse très sédentaire, j’avais des problèmes de circulation sanguine et je prenais du poids. Je produisais trop de cortisol, pas suffisamment de FSH, j’avais un trop plein d’œstrogènes et une baisse de la progestérone (ces deux hormones sont indissociables). Hormis pour la FSH, on ne voyait rien dans mes bilans sanguins, parce que l’équilibre hormonal est tellement fragile qu’il est compliqué de déterminer des déséquilibres à un instant T. Il faudrait pouvoir refaire des analyses à différents moments de la journée et à différents moments du cycle pour percevoir les déséquilibres hormonaux. C’est impossible, c’est pour cela que personne ne prescrit ces analyses. Il est donc indispensable d’écouter les messages de son corps pour mieux comprendre ses fonctionnements.
En tout cas, si nos hormones ne sont pas sécrétées suffisamment, ou si nous sécrétons trop de cortisol et d’adrénaline, par exemple, cet équilibre hormonal fragile se détériore et cela a un impact sur tout le reste du corps. On sait d’ailleurs aujourd’hui que nos émotions désagréables comme la peur peuvent empêcher la bonne circulation des hormones entre notre cerveau et les différentes glandes endocrines du corps. C’est un processus tout à fait naturel de « survie ».
Même si cela me paraissait abstrait de prime abord, comprendre que mon état psychologique avait un impact sur les hormones et altérait le bon fonctionnement de mon organisme (et donc sur l’état de ma peau), a été la première étape de mon cheminement personnel.
Il m’a permis de me rendre compte que je devais aller aussi regarder du côté de la gestion de mes émotions et de mon stress chronique dont j’ai également longuement parlé dans mon article, A Fleur de Peau.
A dire vrai, ce travail de transformation intérieure n’a pas été un chemin facile parce que les gens me voyaient changer. Je continuais donc à vivre des pertes en me mettant en retrait et en ayant beaucoup moins d’interactions sociales. Je ne m’attardais en effet plus sur les mêmes sujets qu’eux, je m’intéressais à des choses différentes, j’expérimentais… Je changeais. Les gens n’aiment pas le changement, comme n’importe qui d’ailleurs…

Crédit photo : Zolotareva Elina
Pression sociale
Mes amis et mes proches se demandaient à quel moment j’allais « me poser », avoir un « vrai » job, gagner « correctement » ma vie, ces années d’errance et d’expérimentations ont été une période très compliquée pour moi parce que les gens me reprochaient maladroitement mon instabilité. En fait, je sais que je les renvoyais à leurs propres insécurités et à leurs propres peurs. J’avais peur moi aussi bien sûr, mais les gens me donnaient encore plus peur avec leur commentaires parfois déplacés et maladroits. A dire vrai, je ne voyais pas à l’époque ce que j’étais en train de construire, mais je continuais mon petit bonhomme de chemin, à mon rythme…
La majorité des gens cherchent la stabilité, certains ont peur de tester de nouvelles choses dans leur vie parce qu’ils ont peur de ressentir de l’insécurité.
Toutefois, la vie est une succession de pertes et de gains. Toute notre vie, nous devons nous adapter et nous préparer à dire au revoir aux personnes que nous aimons, à nous séparer des objets, à ne pas avoir trop d’attaches qui nous sécurisent.
Lorsqu’on reste « enfermé » dans une vie sécurisante, sans trop de changements, le jour où nous devons gérer une perte brutale, une séparation, un traumatisme quelconque, ou un deuil, cela peut devenir rapidement une « descente aux enfers ». En effet, nous vivons ce moment désagréable comme une perte de repères ; quelqu’un qui ne prend ainsi jamais de risques dans sa vie a beaucoup plus de difficultés à se remettre de ces changements brutaux propres à la vie, parce que tous ses repères n’existent plus et il ne se sent ainsi plus du tout en sécurité. Il devient anxieux avec une capacité d’adaptation à la difficulté très peu développée. Le cerveau se met alors en état d’alerte dans l’incapacité de gérer la situation. En réalité, ce qui est inconnu pour un cerveau est perçu comme dangereux, cela engendre ainsi du stress : de la peur. Lorsque j’ai compris cela, je me suis rendue compte que j’ai passé une bonne partie de ma vie à avoir peur.
Gérer une perte
Quelqu’un qui n’a pas peur d’expérimenter (par exemple, changer de travail, se séparer de quelqu’un), de sortir ainsi de sa zone de confort, est beaucoup mieux armé psychologiquement à ces pertes successives propres à la vie, à l’impermanence, et les vivra mieux que quelqu’un qui s’est construit une vie sécurisée, à toujours agir dans la prudence (par peur de justement perdre ses repères).
Lorsqu’on a surmonté une perte, quelle qu’elle soit (changement de travail, rupture amoureuse, déménagement, deuil, maladie, changement d’environnement : départ à la retraite, obtention d’un diplôme, etc.), nous nous rendons compte que ces pertes nous apprennent souvent beaucoup sur nous-mêmes, sur notre capacité à affronter l’adversité, sur notre capacité de résilience, notre capacité à être autonome, cela change notre manière de voir la vie, les autres et nous-mêmes ; cela amènent ainsi toujours à des bénéfices, des « gains » qui nous permettent de grandir de l’intérieur. Autrement dit, nous avons donc beaucoup plus de facilités à gérer les imprévus lorsqu’un changement brutal et désagréable survint dans notre vie.
Les personnes qui souffrent de problèmes de peau ont souvent de grandes difficultés à s’adapter aux changements parce qu’elles sont dans le contrôle, elles se sentent souvent dépassées et n’osent pas partager leur détresse. Elles vivent beaucoup de rebondissements intérieurs, brûlent de l’intérieur, et attendent souvent d’exploser pour exprimer leurs ressentis ; elles ne gèrent pas forcément de la manière la plus adaptée : soit elles explosent, soit elles n’arrivent plus à exprimer ce qui les ronge de l’intérieur parce qu’elles veulent absolument se contrôler face aux autres. J’ai d’ailleurs parlé de cela dans mon article, A Fleur de Peau.
Notre ami le stress
Comme je l’expliquais précédemment, ces personnes produisent souvent trop de cortisol. Bien qu’on l’appelle « l’hormone du stress », elle est bien plus que cela, parce qu’elle est indispensable pour notre corps. En effet, elle régule de nombreuses fonctions de notre organisme : elle est absolument indispensable à notre survie.
Le stress est une réaction physiologique du corps qui nous permet d’avoir un comportement adapté dans une situation de la vie. Pour vivre, nous avons donc besoin d’être « stressés ».
Le cortisol permet de déclencher un mécanisme naturel du cerveau de « lutte » ou de « fuite », c’est ce qu’on appelle donc le stress. C’est un mécanisme qui a permis à l’homme de survivre depuis la nuit des temps pour lui permettre de s’échapper ou de lutter face à un danger, lorsqu’il pouvait potentiellement se faire attaquer par des prédateurs.
Aujourd’hui, nous sommes donc toujours « programmés » de la sorte quel que soit le « danger » que nous vivons. C’est d’ailleurs ce mécanisme qui est enclenché en permanence pour les anxieux chroniques.
A notre époque, nous n’avons plus à faire face à un prédateur ou à un guerrier ennemi ; en revanche, nous devons affronter multiples autres situations de notre vie moderne qui augmentent notre fatigue physique et morale, des émotions désagréables récurrentes (comme la peur par exemple), ce qu’on appelle plus largement aujourd’hui, notre « stress »:
un emploi qui nous épuise
une relation de couple qui peut parfois s’avérer compliquée
des soucis familiaux
des enfants à gérer en plus du travail et de la maison à entretenir
les informations déprimantes dans les journaux au quotidien
une pandémie mondiale qui a eu un impact énorme sur le moral de l’ensemble de la population avec une privation de libertés
les embouteillages, le bruit permanent comme les klaxons, les gens « mal lunés »
le métro
être devant des écrans toute la journée
la gestion de la paperasse administrative, des factures à payer, etc.
En réalité, notre cerveau ne voit pas la différence entre ce qu’il se passe réellement et ce qu’il vit.
En d’autres termes, il ne voit pas la différence entre ces « stress du quotidien » de ceux pour lesquels nous sommes « programmés » depuis la nuit des temps (comme la fuite devant un prédateur ou la lutte face à un guerrier ennemi parce que nous sommes en danger). Puisqu’il ne peut pas percevoir la différence entre ces types de stress, c’est donc le même processus physiologique qui se met en route : le cerveau se met en mode alerte en permanence.
L’effet boule de neige
Dans cette condition de « danger », lorsque le cerveau se met en mode « alerte », il va ainsi puiser dans toutes les fonctions de notre corps qu’il va juger « non essentielles » pour notre survie et va envoyer ce « surplus » d’énergie à celles qu’il considère en avoir le plus besoin pour faire face au « danger » : notamment à notre cœur et à nos muscles.
Ces derniers sont en effet considérés par notre cerveau comme vitaux à notre survie ; notamment pour pouvoir réagir à un prédateur qui nous poursuit, nous avons besoin de nos muscles pour courir vite et de notre cœur pour réguler notre fonction cardiaque et notre pression sanguine. Dans ce cas de figure, nous n’avons donc pas besoin d’avoir de l’énergie dans les fonctions non-essentielles de notre organisme en cas de danger, comme notre système digestif ; c’est d’ailleurs pour cette raison que nombre d’anxieux ont des problèmes digestifs puisque notre énergie est ainsi envoyée ailleurs.
Lorsque nous vivons un stress chronique, notre microbiote digestif est ainsi rapidement altéré. Notre « flore intestinale » a en effet une influence directe sur notre santé non digestive et psychologique. Aussi, notre muqueuse intestinale est plus perméable, ce qui entraîne une fuite des nutriments, des toxines et des bactéries dans le sang. Cela provoque une inflammation dans le corps et, si les autres organes émonctoires tels que les poumons ou les reins, ne sont pas suffisamment sollicités et/ou sont trop engorgés, c’est le dernier organe émonctoire, la peau, qui prend la relève pour libérer tout ces déchets.
Mécanisme de protection et de survie
Lorsque nos niveaux de cortisol restent élevés en permanence parce que nous sommes trop stimulés de toute part (trop de choses à faire, trop de choses à gérer, trop de stress), notre cerveau se met donc en mode « survie ». Ce dernier inhibe certaines de nos fonctions cognitives, il nous coupe au maximum de nos sensations corporelles et il met donc en veille des processus physiologiques indispensables pour le maintien de notre organisme comme la digestion qu’il ne considère plus comme vitale ; il va même jusqu’à maintenir en veille certaines parties de notre cerveau ! C’est la raison pour laquelle nous ne sommes plus en mesure de résoudre certains problèmes, que nous sommes dans ce qu’on appelle un « brouillard mental » ; incapables de se concentrer. C’est aussi la raison pour laquelle nous ne sécrétons plus certaines hormones indispensables pour notre santé globale.
Le « stress » est donc problématique s’il n’est pas lié à un véritable danger de mort comme c’était le cas au temps de l’homme de Cro-Magnon. Si ce « stress » est lié à notre travail ou à notre vie personnelle, à des problèmes familiaux, ou si nous sommes addicts à l’adrénaline comme je l’expliquais précédemment (en situation de « burn in »), notre métabolisme ne sera donc plus suffisamment alimenté, notamment au niveau digestif ou dans certaines zones de notre cerveau, ce qui va donc nous empêcher de nous concentrer, de nous remémorer des informations, de sécréter les bonnes hormones, etc.
Pour conclure, le stress est une stimulation ponctuelle qui nous permet de nous adapter dans les situations de la vie quotidienne. On incrimine communément le stress en le voyant comme le mal incarné mais il n’a absolument rien de terrible ou de négatif. Au contraire, nous avons besoin de ce « stress » pour vivre !
Par exemple, si nous traversons la rue alors que le feu est vert pour les piétons mais qu’une voiture brûle son feu, notre cerveau est programmé pour réagir rapidement ; nos sens nous permettent d’accueillir l’information pour que nous puissions agir en conséquence (grâce à la vue de la voiture et / ou au bruit de celle-ci).
Prenons un autre exemple. Lorsqu’un artiste monte sur scène, son « stress » ponctuel, qu’on appelle communément « trac » est justement très porteur et bénéfique pour lui. Cette peur, cette sécrétion d’adrénaline ponctuelle, peut en effet être un moteur pour vivre des expériences au quotidien, pour oser sortir de sa zone de confort et gagner en confiance en soi.
Par conséquent, le stress devient un véritable problème lorsqu’il est permanent et qu’on le vit de l’intérieur, lorsque la sécrétion d’adrénaline est chronique ; en effet, le stress chronique implique des réponses neuronales, neuroendocrines, métaboliques et comportementales en excès et non adaptées qui nous rendent malades.
Le mécanisme physiologique du stress
Physiologiquement, le stress fonctionne ainsi :
Nous recevons l’information d’un événement / d’une situation de stress par les organes sensoriels (=> Je vois et j’entends la voiture qui arrive vite)
La réaction au stress se programme au niveau de notre cortex cérébral et du système limbique (amygdale, hippocampe, corps mamillaire, etc.). Le cortex et le système limbique permettent d’analyser la situation et de chercher dans leur banque de données (dans nos souvenirs) une expérience commune afin de permettre à notre corps de s’adapter. (=> Je comprends que la voiture va griller le feu parce qu’on me l’a appris lorsque j’étais enfant, ou parce que je l’ai déjà vu dans un film, ou parce que je me suis déjà fait renversée…)
L’organisme va répondre en s’adaptant à la situation grâce à l’amygdale et à l’hippocampe qui agissent directement sur l’hypothalamus et qui auront une action sur les glandes surrénales.
En effet, cette réponse de l’organisme au stress est le résultat d’un réaction hormonale en chaîne. Le cortisol est libéré via les glandes surrénales pour fournir au cerveau un apport en énergie suffisant pour nous préparer à faire face au stress.
Le cortisol intervient notamment dans la régulation de la tension artérielle, de la fonction cardiovasculaire et de la fonction immunitaire. C’est la raison pour laquelle lorsque vous êtes anxieux, vous sécrétez davantage de sébum, vous respirez plus vite, vos muscles se tendent, vous avez les mains moites, vous avez le cœur qui se met à battre plus rapidement et vous transpirez..
Les hormones du stress
Cependant, le cortisol n’est pas le seul à être sécrété par nos glandes surrénales. Il y a en effet quatre autres hormones qui sont sécrétées par nos glandes endocrines (notamment par les surrénales mais aussi par l’hypophyse, comme je l’expliquais précédemment):
-
L’ACTH dont le rôle est de stimuler les glandes surrénales, qui à leur tour libèrent le cortisol.
-
L’adrénaline prépare l’organisme à répondre au stress : le rythme cardiaque et la respiration s’accélèrent, la pression artérielle augmente.
-
L’ocytocine intervient notamment au niveau de notre comportement en société.
-
La vasopressine, également appelée hormone antidiurétique, permet de réguler les fonctions urinaires (lorsque vous avez envie d’aller uriner quand vous êtes dans une situation de stress), ainsi que la pression sanguine. La vasopressine joue un rôle important dans la gestion de l’anxiété.
On parle donc toujours du cortisol, mais cette hormone n’est pas la seule à être en charge de notre comportement face aux situations de « stress ponctuel » pour nous adapter à notre environnement, et face aux situations chroniques « anxiogènes » (les situations récurrentes qui provoquent ainsi un déséquilibre hormonal permanent).
En effet, lorsque ces hormones que je viens de mentionner sont produites en excès, vous ne produisez donc plus les hormones indispensables pour votre santé : les autres hormones stéroïdiennes, les fameuses hormones sexuelles comme les œstrogènes, la progestérone et les androgènes. C’est ce que je vous expliquais précédemment avec ma condition d’anxiété chronique (prise de poids, problème de circulation sanguine, etc.).
Notons que l’équilibre de ces hormones est très fragile. Pour nous, les femmes, nos taux d’hormones stéroïdiennes fluctuent également selon notre cycle menstruel. Si vous ajoutez donc du stress chronique à cela, c’est le déséquilibre hormonal assuré, pouvant même aller jusqu’à des problématiques plus lourdes telles que l’acné adulte persistante, les maladies auto-immunes, l’aménorrhée (absence de règles), l’endométriose, un fibrome utérin, etc. parce que notre cerveau nous coupe volontairement de nos ovaires, de nos intestins ou de notre thyroïde puisqu’il est affairé à lutter contre le danger : c’est l’anxiété chronique. C’est pourquoi j’attache une importance extrême sur ce point dans mon programme en ligne et coaching de groupe A Fleur de Peau.

Crédit illustration : Anastasiia
Accepter son anxiété
Pour me sortir de mon combat contre l’acné (entre autres), pour ma guérison, il m’a ainsi fallut faire un gros travail de gestion de mon anxiété et de mes émotions.
Il m’a fallu accepter dans un premier temps que j’étais une personne anxieuse, que j’avais le droit de l’être et que c’était ok.
Par ailleurs, alors que je débordais d’émotions intenses à l’adolescence, je me suis rendue compte que j’avais une grande difficulté à différencier et à exprimer mes émotions plus tard, à l’âge adulte.
J’étais dans le contrôle en permanence et jamais je me laissais accueillir mes émotions. Par exemple, jamais je ne pleurais. Pourtant, les pleurs sont justement l’expression d’une réaction à des émotions (tristesse, peur, colère, joie). Pleurer est donc un stress, c’est une réaction normale et adaptée selon ce que nous vivons comme émotion, contrairement à ce qu’on veut malheureusement parfois laisser paraître (« pleurer c’est pour les « faibles »). En effet, les pleurs engendrés par ces émotions provoquent ainsi la libération d’hormones, dont l’ocytocine, qui régule nos comportements ; la vasopressine, qui agit sur la pression sanguine et la gestion de l’anxiété ; et surtout le cortisol et l’adrénaline. Pleurer est bon pour la santé ! Cela permet d’éliminer les hormones en excès !
Il m’a également fallut me sortir de mon enfermement, de ma prison mentale et physique. J’ai dû peu à peu laisser tomber ces couches de moi-même, qu’on peut éventuellement voir comme les fameuses enveloppes de l’âme qu’on appelle les Kosha dans la tradition du Yoga, sortir de mes idées préconçues sur la vie, sur le monde et sur les autres pour me permettre d’être plus bienveillante et moins dans le contrôle.
Il m’a ainsi fallut me rendre compte que je n’étais pas du tout bienveillante envers moi-même, que je vivais en pilote automatique, déconnectée de mon corps, j’étais anxieuse mais cela n’étais pas la fin du monde !
Enfin, il m’a fallut m’arrêter de me rentrer dans une case qui me poussait à être tout le temps dans le jugement et me mettais une pression supplémentaire, accroissant considérablement mon anxiété : « je suis yogi donc je ne dois pas manger de viande et je dois pratiquer tous les jours », « je suis métalleuse donc je suis considérée comme quelqu’un de mal dans sa peau », « je ne suis pas fille « de » donc je ne réussirai jamais et je ne sortirai jamais de la condition sociale», « le yoga et le métal sont deux univers différents qui ne vont pas ensemble, je dois garder sous silence cette passion pour la musique dite « extrême » sinon je serai mal perçue par la communauté du bien-être », « je suis introvertie, je ne pourrai donc jamais rien faire en lien avec la sphère publique et je ne pourrai jamais être sur les réseaux sociaux », etc.
Toutes mes croyances m’ont conduites à une anxiété chronique parce que je n’étais plus du tout moi-même, je devais « dealer » avec mes difficultés dans ma vie personnelle et je devais en plus faire attention à l’image que je renvoyais au monde, j’avais peur du regard des autres et d’être rejetée comme j’avais pu l’être étant enfant.
Se définir
En réalité, si je pensais tout cela, c’est aussi parce que nombre de personnes m’ont mise volontairement dans des cases depuis que j’étais enfant ; je continuais ainsi à me rentrer dans ces mêmes cases parce que je ne me connaissais pas vraiment, j’existais uniquement dans le regard des autres, non pas pour moi-même. Je continuais alors à me mettre inconsciemment dans ces cases, et, par là-même, à accepter qu’on me rentre dans des cases !
Cette manière de compartimenter les choses et de mettre les gens dans « des cases » est typique de la pensée occidentale ; j’ai d’ailleurs compris que le temps que je penserais de cette manière, je ne sortirai jamais du jugement et du sentiment de frustration intrinsèquement liés à cette manière de penser.
A vouloir absolument me définir et à répondre à des critères, je m’enflammais de l’intérieur parce que je niais ma personnalité et j’étais en véritable conflit avec moi-même. J’avais donc de l’acné.
La mue
Mon travail sur moi-même n’a pas toujours été très confortable à dire vrai, parce qu’il m’obligeait à me regarder en face, à accepter que j’étais responsable de tout ce que je vivais et de ce que je ressentais. J’ai vécu nombre de prises de conscience à propos de mes modes de fonctionnement et de ce qui m’empêchait vraiment de m’épanouir et de me sentir bien dans ma peau.
En toute honnêteté, j’ai appris à me détacher de beaucoup de choses auxquelles je m’accrochais fermement, et j’ai ainsi vraiment eu la sensation de faire tomber mon ancienne peau, vivre cette mue du serpent.
Ce travail profond m’a véritablement transformée de l’intérieur. Je me suis apaisée, l’inflammation de mon corps également. Mon système nerveux s’est apaisé car je n’ai plus eu peur de m’arrêter, de faire les choses à ma manière, et mon équilibre hormonal, si fragile, s’est rétabli progressivement. Tout cela s’est donc vu à l’extérieur, parce que j’ai littéralement changé de peau.
Lorsque je regardais la peau de mon visage qui était recouverte de kystes enflammés, je ne croyais pas que je m’en sortirais un jour. J’étais à la limite de reprendre Roaccutane, mais j’avais cette petite voix à l’intérieur de moi qui me poussait à ne pas aller vers cette “facilité” qui comportait de nombreux risques pour ma santé. Je savais que cette expérience difficile, cette souffrance, me mènerait à un bénéfice extraordinaire ; comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, si ma peau m’a fait souffrir, elle m’a offert un grand cadeau : la transformation de moi-même.
Alors, oui, j’ai erré, j’ai pris des détours, je me suis perdue, j’ai fait des retours en arrière, j’ai testé des tas de choses lorsque j’étais malade, qui m’ont coûté des cicatrices profondes, j’ai testé des tas de régimes “sans”, pris des tas de compléments ; et puis mon levier dans ma guérison a été d’accepter de faire un travail profond sur moi-même, lorsque le moment a été venu pour moi. Ce travail a été le véritable levier pour ma guérison parce qu’il m’a permis de trouver la joie et la paix à l’intérieur de moi-même.
Pour arriver à mettre en place de nouvelles habitudes sur la durée, il est absolument indispensable de faire un gros travail sur le mental, et de faire tomber l’ancienne peau pour aller travailler au cœur de soi-même, c’est ce que j’ai à cœur de faire avec mes clientes en individuel mais également au sein de mon coaching de groupe A Fleur de Peau.
D’ailleurs, si tu ne veux pas manquer la réouverture de mon programme A Fleur de Peau (destiné aux femmes anxieuses qui souhaitent résoudre leur acné adulte récalcitrante de façon sûre, naturelle et durable), n’hésite pas à t’inscrire à ma lettre mensuelle ici.
Dans l’attente de te lire et/ou peut-être de faire ta connaissance. J’espère que cet article te permettra peut-être quelques prises de conscience.
Prends bien soin de toi,
Alexandra
Quelques références pour aller plus loin :
Levenson, R. W. (2003). Blood, sweat, and fears: The autonomic architecture of emotion. Emotions Inside Out, eds Ekman P., Campos J. J., Davidson R. J., DeWaal F. B. M. (Annals of the New York Academy of Sciences, New York), 1000, 348–366. https://psycnet.apa.org/record/2004-00327-012
https://psychaanalyse.com/pdf/HYPOCONDRIE_ANXIETE_ANGOISSE_STRESS_ET_DEPRESSION_EN_HORMONOLOGIE.pdf